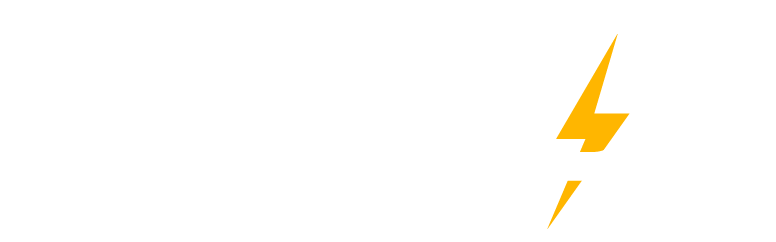Il y a des campagnes qui cherchent à faire parler. Et d’autres qui se retrouvent, malgré elles (ou pas) au cœur d’un champ de mines culturel.
C’est ce qui arrive à American Eagle, après avoir dévoilé sa dernière campagne mettant en scène l’actrice Sydney Sweeney et un slogan à double lecture : “Sydney Sweeney has great jeans”. Derrière ce jeu de mots, un mélange glissant entre marketing, génétique et idéalisation d’un certain corps féminin, qui a enflammé les réseaux sociaux et relancé, une fois de plus, le débat sur la représentation et l’intention des marques dans l’espace public.
Un jeu de mots lourd de sens dans une Amérique à vif
Ce qui devait être une campagne de rentrée légère et stylée s’est transformé en polémique nationale. Le slogan, qui joue sur la proximité phonétique entre jeans et genes (gènes), a été perçu comme une allusion au patrimoine génétique supposément “parfait” de Sweeney, jeune femme blanche, blonde, aux yeux bleus. Un visuel projeté à Times Square, une série de vidéos sur les réseaux, un clin d’œil jugé “malin” par certains… mais dérangeant voire dangereux pour beaucoup d’autres, qui y ont vu une esthétique eugéniste sous-jacente.
Le timing n’a rien arrangé. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025, les standards de beauté traditionnels ont refait surface dans l’espace médiatique, portés par des mouvements conservateurs très actifs. Résultat : la campagne a vite été perçue comme un symbole involontaire (ou non) d’un retour en arrière dans la représentation des corps et des identités. Les accusations de racisme, de suprématie blanche ou de glorification du regard masculin hétérosexuel se sont multipliées, forçant la marque à retirer plusieurs vidéos de ses réseaux.
Une stratégie risquée… mais pas forcément hasardeuse
Face à la tempête, ni Sydney Sweeney ni American Eagle n’ont réagi publiquement. Pourtant, le mouvement en bourse est sans équivoque : +16 % pour l’action de la marque en quelques jours. De quoi faire réfléchir sur la véritable nature de cette campagne. Était-ce une maladresse ? Ou une stratégie consciente de créer du bruit pour faire vendre ?
Des analystes comme Leila Fataar (Platform13) et Jean-Pierre Lacroix (Shikatani Lacroix) rappellent que les campagnes ne vivent pas dans le vide. Elles atterrissent dans une culture, dans un moment. Et ce moment, aux États-Unis, est particulièrement tendu. Ce que certains qualifient de “culture woke” est aujourd’hui attaqué frontalement par des figures médiatiques et politiques. Pour les marques, prendre part à cette guerre symbolique, même involontairement, peut s’avérer explosif… ou rentable.
LIRE AUSSI : Astronomer transforme un scandale en masterclass de com avec Gwyneth Paltrow
Mais à quel prix ? La promesse initiale de la campagne (reverser les bénéfices des jeans “Sweeney” à une association de lutte contre les violences domestiques) est passée au second plan, noyée dans le bruit du scandale. Une belle intention gâchée par une exécution mal cadrée.
Un cas d’école pour les marques en 2025
Cette affaire est un rappel brutal pour les départements marketing : à l’heure où chaque image est analysée, chaque mot décortiqué, la moindre ambiguïté peut déraper. Une campagne peut séduire une partie de l’audience tout en blessant profondément une autre. Le “coup” devient vite “coupable”. Et dans un climat où les consommateurs attendent plus que jamais des marques de la cohérence, de la responsabilité et de la diversité, ce genre de tempête peut laisser des traces durables.
Conclusion
American Eagle pensait sans doute signer une campagne drôle, audacieuse, peut-être même virale. Au lieu de ça, la marque se retrouve à incarner malgré elle le retour du vieux monde publicitaire, où la provoc’ l’emporte sur la nuance. Une leçon de plus pour les marques de 2025 : toucher à la culture, c’est toucher à du vivant. Et sans écoute réelle, même un simple jean peut devenir une ligne de fracture.
LIRE AUSSI : Smash réagit au bad buzz de WeTransfer et défend la confidentialité